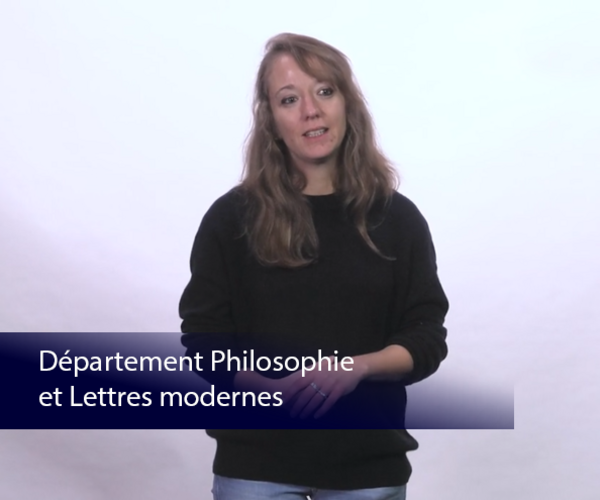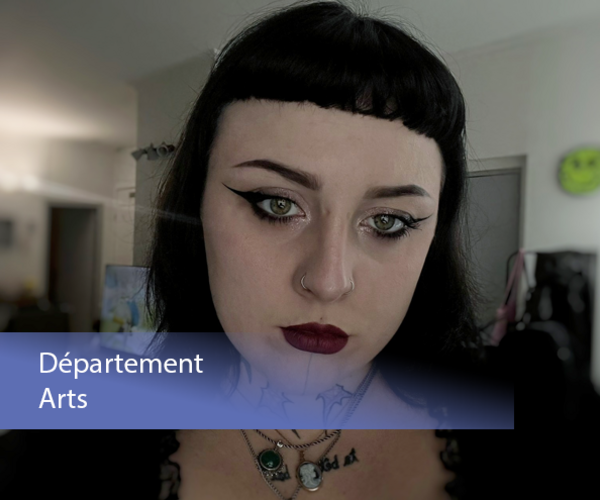Construire son avenir
Faculté des Humanités
Faculté des Humanités
Témoignages de diplômé·es et d'étudiant·es
Découvrez des témoignages d’alumni au sujet de leur parcours professionnel et d’étudiant·es à propos de leur expérience de stage ! De nouveaux témoignages, sous forme d'article ou de portraits-vidéos sont régulièrement publies sur la page LinkedIn ainsi que sur le compte Instagram de la Faculté.
Retrouvez également des témoignages inédits sur la communauté Lilagora de la Faculté des Humanités. Vous devez être inscrit·e sur Lilagora et demander à rejoindre la communauté de la Faculté des Humanités pour accéder à ces témoignages.